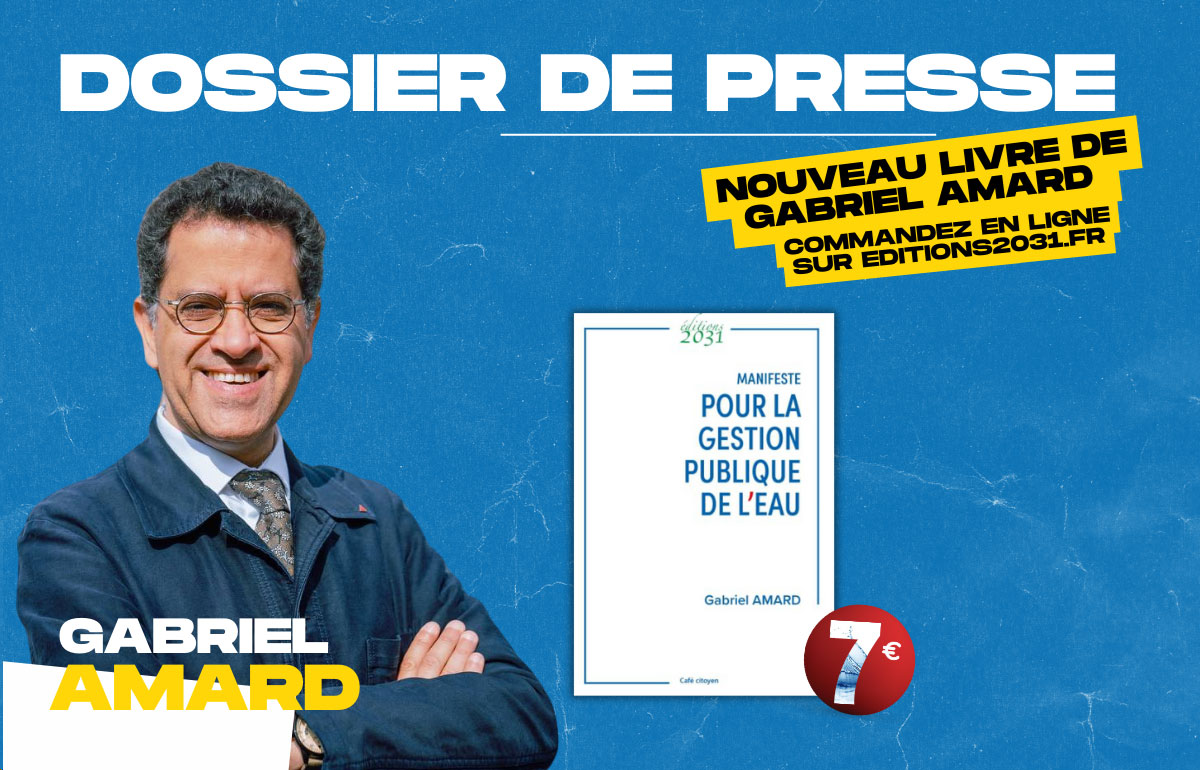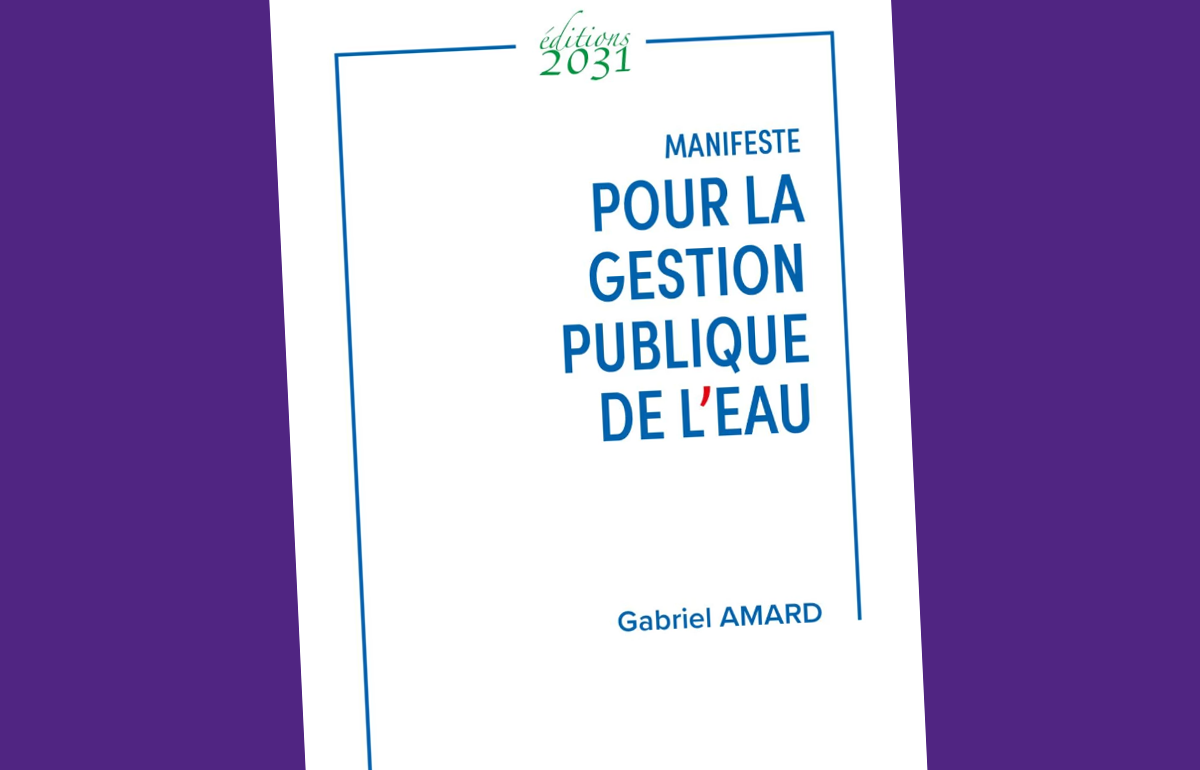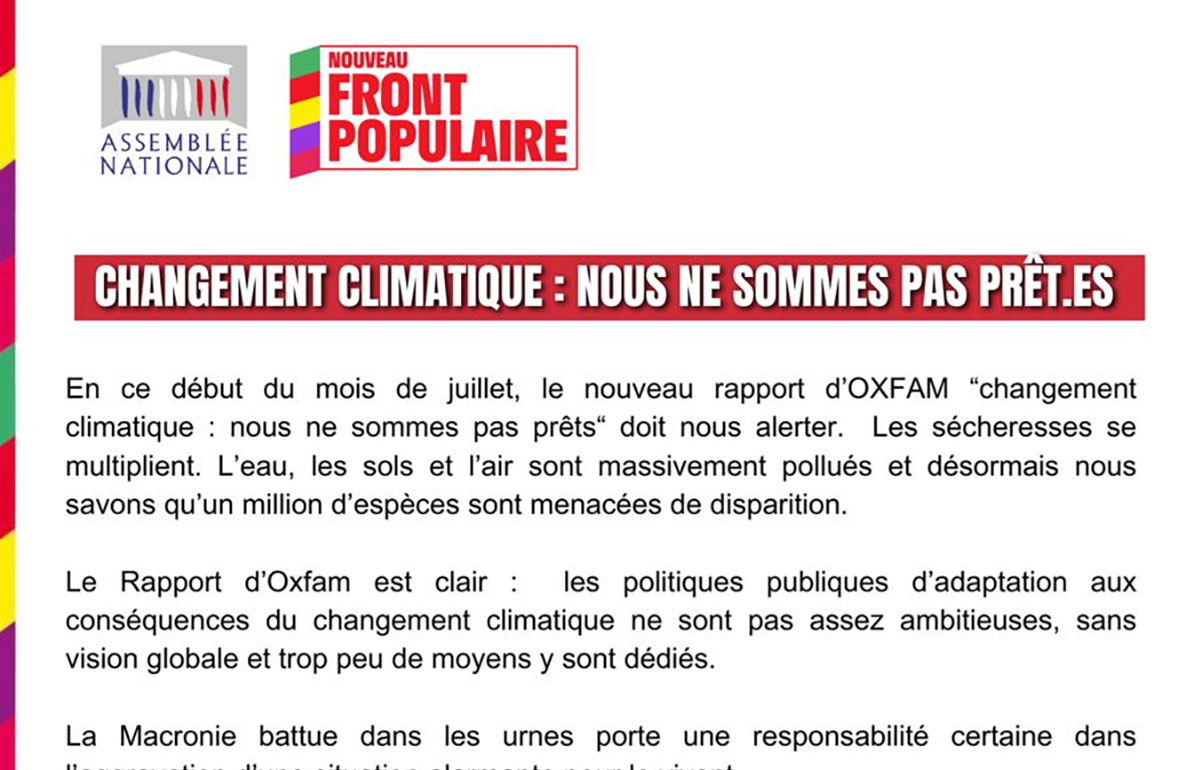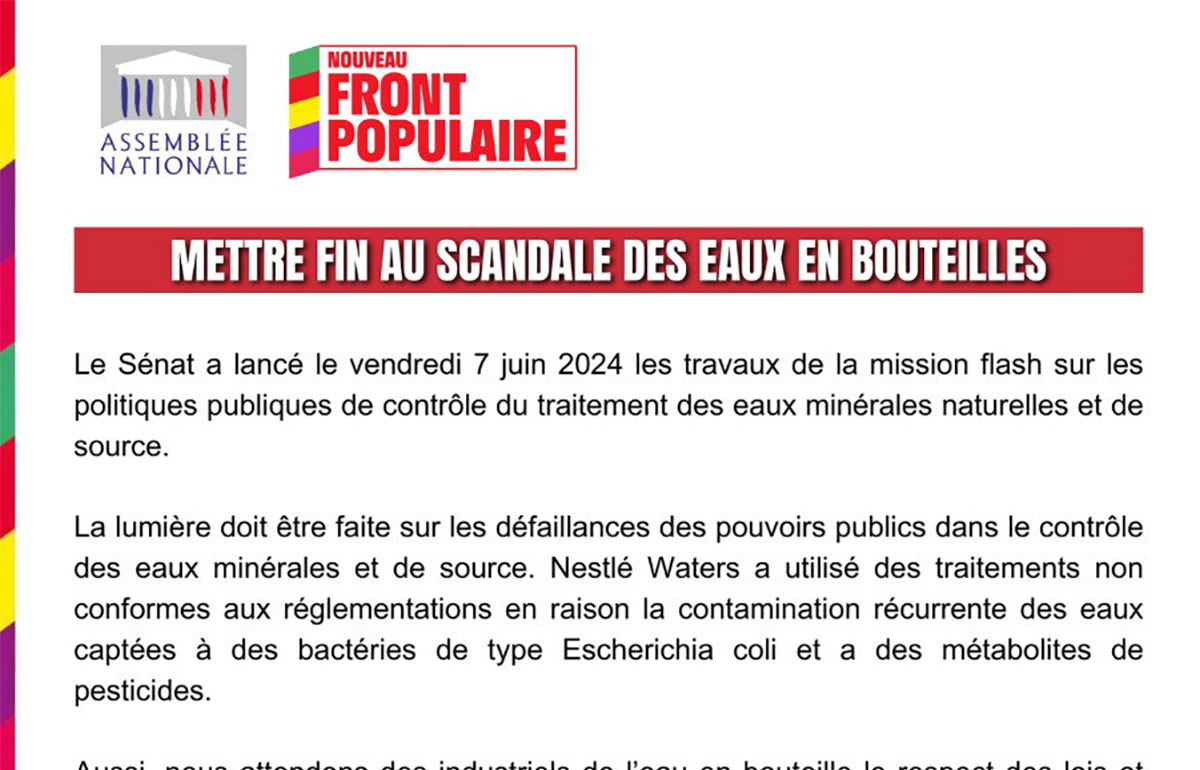Discours de Gabriel Amard, Rapporteur spécial du droit à l’eau à l’APM
Discours de présentation du Rapport et de la Résolution
« Le droit à l’eau potable et à l’assainissement comme un droit de l’homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’hommes dans les régions euro-méditerranéennes et du Golfe »
Monsieur le Président Mavara, Excellences,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
L’eau est source de vie, fondement de nos civilisations et condition première de toute existence humaine. Pourtant, en ce XXIe siècle, des millions de nos concitoyens méditerranéens et du Golfe en sont encore privés. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement, pourtant reconnu comme un droit humain fondamental par les Nations unies en 2010, demeure un privilège pour certains et une lutte quotidienne pour d’autres.
En tant que Rapporteur spécial de l’APM pour le droit à l’eau et à l’assainissement, j’ai l’honneur de vous présenter le Rapport « Le droit à l’eau potable et à l’assainissement comme un droit de l’homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme dans les régions euro-méditerranéennes et du Golfe », ainsi qu’une résolution qui est le fruit de la réflexion de ce rapport.
Avant de vous présenter le fruit de ce travail, je tiens à réitérer ma gratitude au Parlement italien et à la ville de Rome pour avoir généreusement accueilli cette 19e session plénière de l'Assemblée. Grazie a tutti voi.
Je veux également remercier toutes les délégations qui ont activement contribué à la finalisation du projet de résolution, notamment la Palestine, la Turquie, la Grèce, Chypre et Malte, à travers des propositions d’amendements.
Comme l'a déjà mentionné le Président Roque, les propositions d'amendement présentées après la date limite n'ont pas pu être incluses dans la résolution, ainsi que celles qui ne se référaient pas à un paragraphe existant du texte original, comme le prévoit l'article 17 du Règlement des commissions permanentes. Néanmoins, j’ai les ai toutes lues avec attention et propose de les garder en mémoire comme base de travail pour le futur à l’APM puisque nous allons poursuivre ensemble nos travaux sur des thèmes.
Je remercie la délégation de Chypre pour ses deux remarques sur l'annexe 1 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui ne réglemente qu'une vingtaine de molécules de PFAS.
En effet, vous avez raison, collègues et ami·es de Chypre, il faut se préoccuper de la réglementation de l’ensemble de la famille des PFAS et non de quelques molécules. La question des seuils d’études de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) doit être repensée par les institutions de l’Union européenne.
L’APM doit de même étudier les conséquences de la présence de PFAS dans nos chaînes alimentaires et écosystèmes euro-méditerranéens et du Golfe.
Nous retrouvons ces polluants dans la cosmétique waterproof, les ustensiles de cuisine, les emballages alimentaires, les couches pour bébé, les textiles de la vie quotidienne. On les utilise absolument partout.
Je remercie également la délégation palestinienne pour son amendement sur les systèmes d’approvisionnement en eau et en assainissement dans la bande de Gaza. L’eau, droit fondamental reconnu par les Nations unies, ne peut être instrumentalisée comme cible de guerre.
Collègues,
Je me tiens devant vous aujourd’hui non seulement en qualité de Rapporteur spécial de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée sur cette question vitale, mais en tant que citoyen du pourtour méditerranéen, témoin des injustices hydriques qui fracturent notre région et menacent notre avenir commun. Je vous exhorte à agir avec détermination et à faire de cette Assemblée un levier puissant de transformation.
L’eau est une urgence environnementale et sociale
Nous le savons tous : la Méditerranée est la région du monde qui se réchauffe le plus vite. Ce changement climatique accélère les sécheresses, intensifie les inondations et bouleverse les cycles hydrologiques.
Mais à cette pression climatique s’ajoutent nos propres responsabilités : la surexploitation des eaux souterraines, une irrigation inefficace, la pollution galopante, autant de facteurs qui transforment l’eau en un bien de plus en plus rare et inégalement réparti. D’ici à la fin du siècle en 3 générations nous allons soit détruire toute vie toute biodiversité en Méditerranée soit nous allons accompagner sa résilience en vivant en harmonie avec elle.
Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sont déjà considérés comme des “points chauds mondiaux pour l’utilisation non durable de l’eau”. La surexploitation de cette ressource y est devenue si extrême que la nature n’a plus le temps de se régénérer. Nous épuisons nos réserves plus rapidement qu’elles ne se reconstituent.
Et que dire des polluants éternels, ces PFAS qui empoisonnent nos eaux ? Ils sont partout : dans nos rivières, nos nappes phréatiques, nos océans, nos aliments. Certaines de ces substances sont déjà reconnues comme cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer. Pourtant, nous continuons à les répandre, sans réel contrôle, sans réelle prise de conscience. L’Union européenne ne réglemente qu’une vingtaine de ces molécules, alors que nous en connaissons des dizaines de milliers !
La crise de l’eau n’est pas seulement écologique : elle est aussi politique. Nous ne pouvons fermer les yeux sur l’instrumentalisation de l’eau comme moyen de pression, voire comme arme de guerre. La bande de Gaza en est un tragique exemple. Quand on prive un peuple de son accès à l’eau potable et à l’assainissement, on ne se contente pas de violer ses droits fondamentaux : on met en péril sa survie même.
Nous devons défendre, ici et maintenant, une position sans ambiguïté : l’eau ne peut être une arme. Elle est un droit inaliénable, non négociable. Il est de notre responsabilité de garantir que personne ne puisse être privé de ce droit fondamental pour des raisons géopolitiques.
Des solutions existent si nous faisons un choix politique.
Face à ce constat, devons-nous céder au fatalisme ? Non ! Il existe des solutions. La Slovénie a inscrit le droit à l’eau dans sa Constitution. L’Acquedotto Pugliese, en Italie, a mis en place des technologies innovantes qui optimisent la gestion de l’eau. Ce ne sont pas de simples initiatives locales : ce sont des modèles à suivre, des preuves que des politiques publiques volontaristes peuvent faire la différence.
Nous avons aujourd’hui le devoir d’aller plus loin. De bâtir un cadre juridique solide, d’investir massivement dans des infrastructures résilientes, d’adopter des lois qui garantissent que chaque habitant de notre région, indépendamment de sa condition sociale ou de sa nationalité, puisse jouir de son droit à l’eau.
Mais il y a un combat supplémentaire à mener, un combat audacieux, essentiel : la reconnaissance de la mer Méditerranée comme entité juridique.
Donner une voix à la Méditerranée pourrait être un symbole de paix et de responsabilité ?
La Méditerranée n’est pas un simple espace maritime. Elle est notre bien commun, le lien historique et écologique qui unit nos peuples depuis des millénaires. Or, elle est aujourd’hui en péril : pollution, surpêche, réchauffement, eutrophisation.
Nous avons une responsabilité collective : c’est pourquoi je vous demande de bien vouloir accepter que nous puissions explorer ensemble toutes les options pour donner à la Méditerranée la personnalité juridique au regard des menaces qui pèsent sur elle.
Certains s’en inquiètent, redoutant un “big bang juridique”. Je leur réponds : n’ayez pas peur d’ouvrir ce débat.
Collègues grecques et turques : D’autres écosystèmes ont déjà franchi ce cap. En Espagne, la lagune du Mar Menor bénéficie d’un statut juridique propre, ce qui lui permet d’être défendue devant les tribunaux et de mobiliser des protections inédites. Pourquoi ne pas étendre cette logique à la Méditerranée tout entière ?
Nous avons déjà des bases solides sur lesquelles nous appuyer, notamment la Convention de Barcelone de 1976. Il ne s’agit pas de révolutionner le droit, mais de l’adapter à notre temps.
En reconnaissant la Méditerranée comme entité juridique, nous enverrions un message fort : celui d’une Méditerranée unie, non comme un champ de rivalités, mais comme un espace de solidarité et de coopération.
Je vous abjure de prendre un engagement pour l’avenir.
Nous ne pouvons plus nous contenter de discours d’alerte. Nos peuples attendent des actes. Nos enfants nous jugeront sur notre capacité à agir maintenant.
Je vous appelle donc, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, à faire de cette Assemblée parlementaire de la Méditerranée un véritable moteur de transformation. Nous avons entre nos mains un rapport qui établit un constat implacable, mais aussi une résolution qui ouvre des pistes concrètes. Saisissons cette opportunité pour faire de l’accès à l’eau un droit réel et pour protéger la Méditerranée comme elle le mérite.
L’histoire jugera notre action. Soyons à la hauteur du défi.
Et puisqu’il faut conclure, je laisserai la parole à l’un de nos plus grands penseurs méditerranéens, Albert Camus, qui nous rappelait que :
“La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent.”
Alors donnons tout, dès aujourd’hui, pour l’eau, pour la Méditerranée, pour la vie.
Je vous remercie.